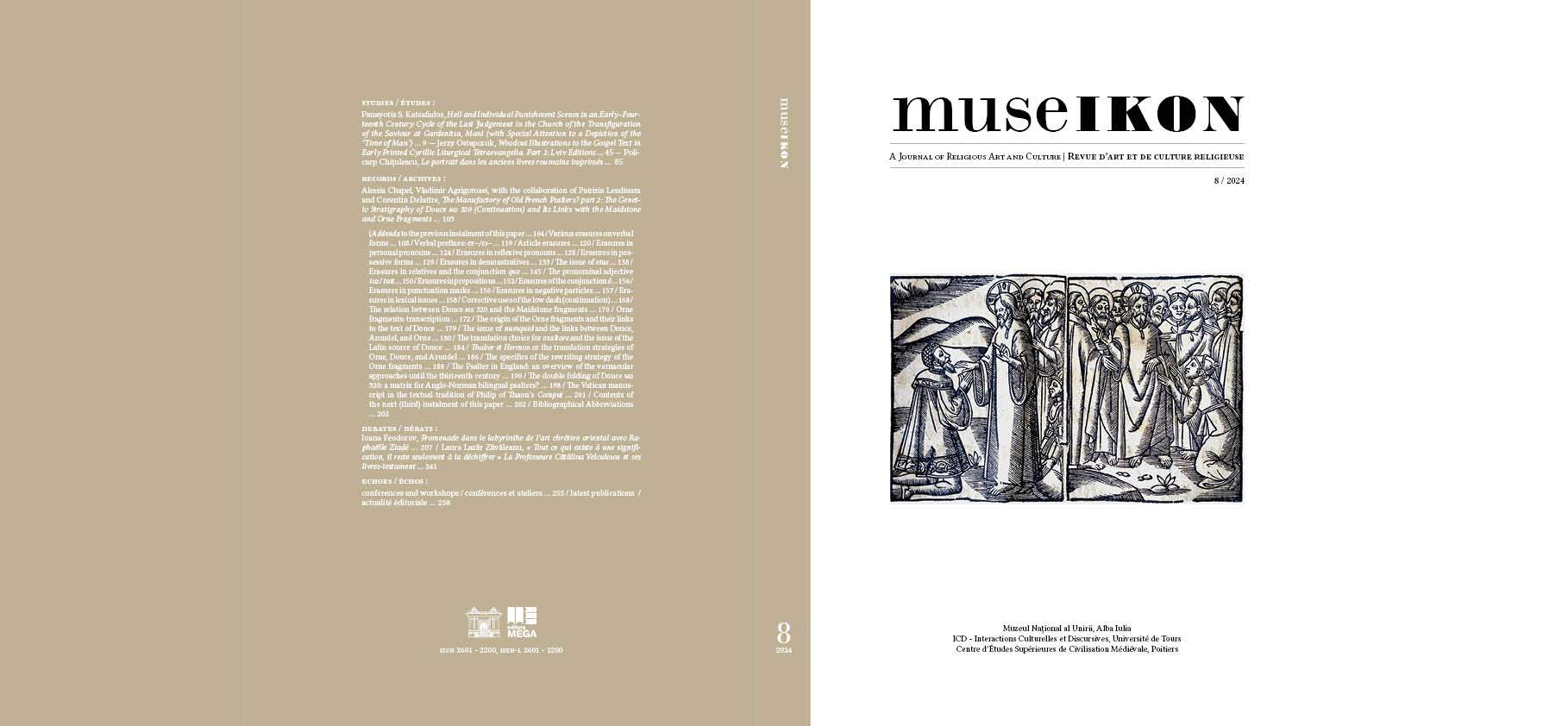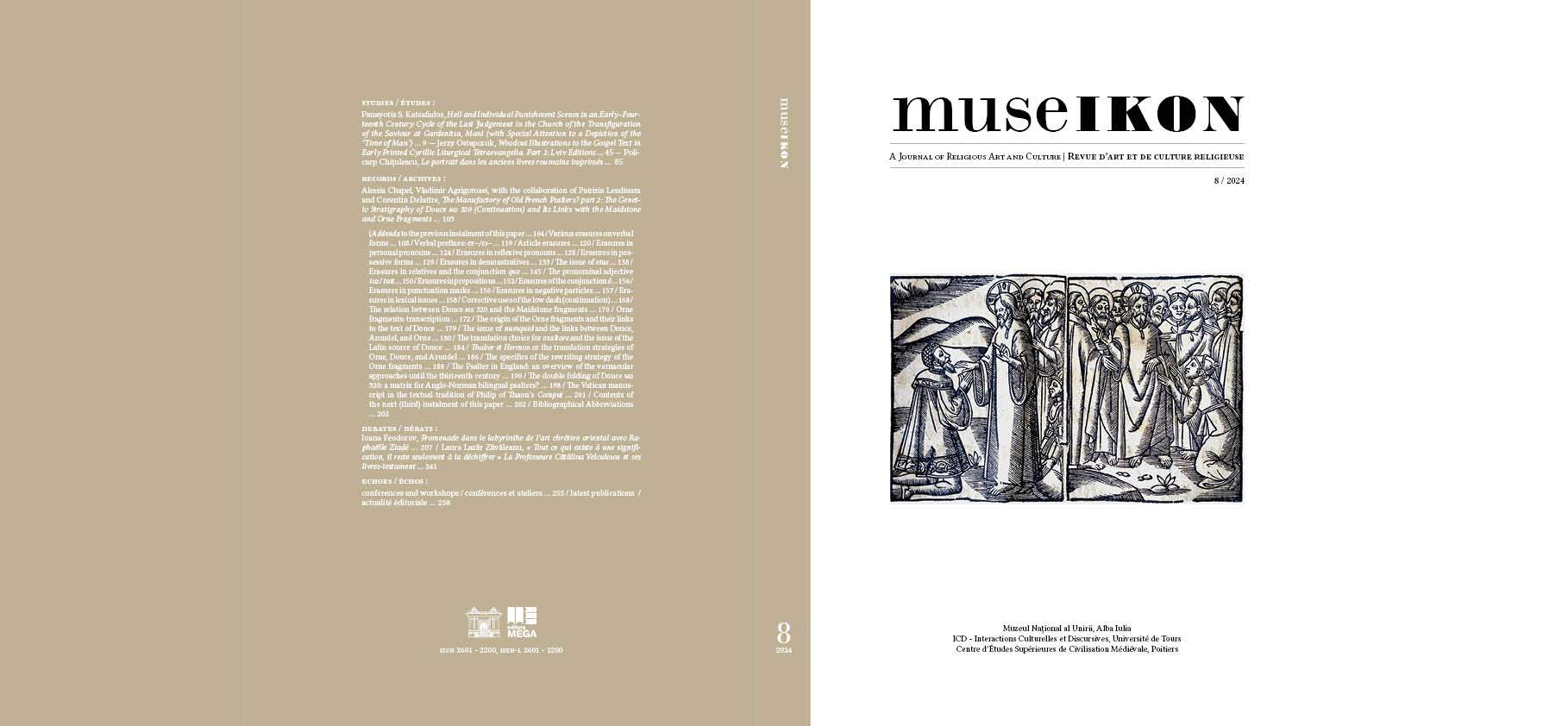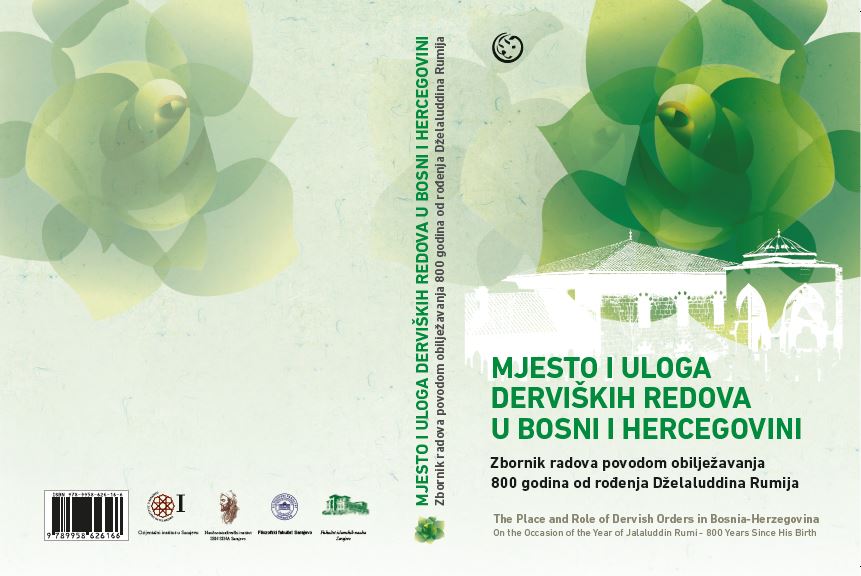
We kindly inform you that, as long as the subject affiliation of our 300.000+ articles is in progress, you might get unsufficient or no results on your third level or second level search. In this case, please broaden your search criteria.
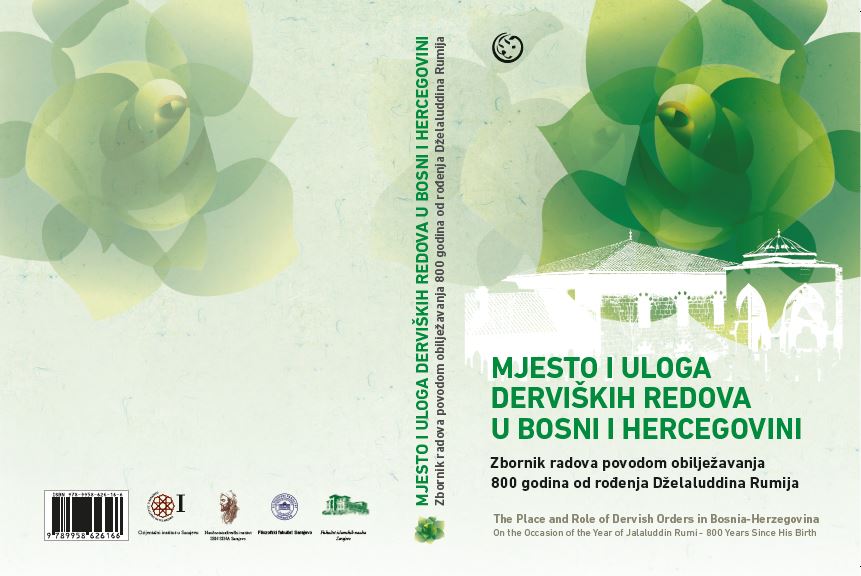
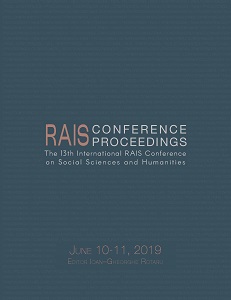
ABSTRACT: Melancholy has long been considered a negative state of being. However, negative interpretations fail to appreciate its positive potential. Melancholy and its effect can potentially benefit, not just an individual but a community. Changing attitudes towards the idea of melancholy in American culture may happen if the strategy of defining it is adapted. This paper focuses on how Emilio Uranga defines melancholy and how his philosophy can benefit a better understanding of melancholy in a communal dimension. The role of communal melancholy in Korean culture after colonialization exemplifies the way in which melancholy presupposes and manifests freedom and is a condition of authenticity.
More...
REVOEW OF: Ljubomir Cvijetić: Prevarene riječi , Svjetlost, Sarajevo, 1973.
More...

REVIEW OF: Rudi Supek: »Društvene predrasude«, Radnička štampa, biblioteka »Ideje«, Beograd, 1973
More...
Après avoir reconfirmé la datation de Camille Enlart (vers 1421 ou 1421-1424) et identifié le comman-ditaire (l’évêque de Limassol Barthélemy Gui) dans une inscription fragmentaire, la présente étude explore: d’une part, les modèles des inscriptions en langue vernaculaire française de Pyrga (Chypre); d’autre part, la lo-gique du programme iconographique et le contexte culturel que sous-tend cette dernière. Dans la première par-tie, l’analyse des inscriptions de la chapelle prouve que le concepteur du décor peint a suivi un modèle manuscrit, sans doute un psautier avec un grand cycle d’enluminures. L’étude évoque trois termes de comparaison célè-bres: le Psautier de la reine Ingeburge (Chantilly, Bibliothèque du Musée Condé, 9 – tournant du xiiie siècle), le psautier de l’évêque Henri de Blois (Londres, British Library, Cotton Nero C iv – vers 1160) et le livre d’images de Marie de Rethel (Paris, Bibliothèque nationale de France, n. acq. fr. 16251 – vers 1285). Dans la source manuscrite reconstituée, les inscriptions en ancien français étaient probablement transcrites en tant que tituli, d’après une typologie tripartite: noms de fêtes religieuses, groupes nominaux ayant une fonction analogue et légendes sous forme d’énoncés introduits par l’adverbe coument. La langue des inscriptions de Pyrga, un français d’Outremer, présente les traits particuliers des scriptae chypriotes de la fin du Moyen Âge. De plus, on constate que la déco-ration de la chapelle inscrit le monument de Pyrga dans la catégorie des chapelles royales de l’Europe occidentale (xive et xve siècles). Le transfert du codex à la paroi concerne non seulement les images, mais également les textes qui accompagnent ces dernières. L’auteur s’intéresse ensuite à la disposition symétrique de la décoration dans les deux travées de la chapelle, ainsi qu’à la manière dont cette disposition accentue l’Uniatisme catholique-orthodoxe. La logique dos-à-dos de la décoration émule celle des icônes à double face – termes de comparaison directs pour la chapelle – notamment leur choix d’apparier deux scènes : la Crucifixion / la Mère de Dieu. Le con-cepteur du décor peint souhaitait évoquer l’osmose de deux églises: une église latine, orientée vers l’Est; la sug-gestion d’une église byzantine, orientée vers l’Ouest. Cela explique le choix particulier de la décoration des voûtes (christologique pour la travée Est et mariale pour la travée Ouest), la double représentation de l’An-nonciation (pour marquer l’orientation des deux églises) et le choix d’une composition de type pala d’altare pour la paroi Est, tandis que la paroi Ouest imite la décoration des templons byzantins. L’osmose des deux églises est indiquée de manière encore plus claire par le choix de représenter les martyriums des saints Étienne (signifiant l’Orient) et Laurent (signifiant l’Occident) au-dessus des entrées latérales. Ce serait une allusion à l’osmose des corps de ces saints dans la Coniunctio corporum sanctorum Stephani et Laurentii (bhl 4784b). Après une réévaluation du texte fragmentaire (aujourd’hui perdu) de l’inscription dédicatoire, il est évident que la dédicace proprement dite concernait l’Assomption de la Vierge. Qui plus est, l’osmose Est-Ouest était de nou-veau indiquée par la représentation dans un même cadre de la Dormition de la Mère de Dieu (sujet à connotation byzantine) et du Couronnement de la Vierge (thème occidental par excellence). Les textes littéraires des xive et xve siècles confirment la fixation chypriote de l’appariement de la Mère de Dieu avec la Passion du Christ, de même que plusieurs autres choix de la décoration de Pyrga. La signification de la décoration devait être multiple, en rapport avec la triple utilité du bâtiment: chapelle funéraire (pour Barthélemy Gui), chapelle royale (pour le couple Janus de Lusignan-Charlotte de Bourbon) et point d’entrée au monastère de Stavrovouni, qui hébergeait des reliques de la Sainte Croix.
More...
Dans les églises de rite byzantin, les ‘portes royales’ de l’iconostase se distinguent par leur richesse, leur étrangeté et leurs mystérieux ornements. Malgré le rôle décoratif essentiel qu’ils jouent, la finalité de ces traits caractéristiques demeure souvent obscure. Le manque d’explication cohérente devient ainsi l’un des défis scientifiques les plus stimulants à relever, afin d’en clarifier la signification. Étant donné que les recherches en ce sens sont encore absentes du panorama critique de l’histoire de l’art post-byzantin, mettre l’accent, dans une analyse du symbolisme des ‘portes royales’, sur une province lointaine telle que le Maramureș pourrait surprendre. La présente étude se propose toutefois d’interpréter la décoration des ‘portes royales’ au sein du cadre strict de l’espace rituel et culturel byzantin dans le territoire des Carpates du Nord à l’époque prémoderne, en s’appuyant, pour ce faire, sur des écrits religieux contemporains des objets étudiés. Puisque ces écrits, à travers les traductions en langue vernaculaire, ont influencé la culture populaire de la région, la décoration des ‘portes royales’ doit être interprétée en clé mariale. Aussi, tous les traits caractéristiques, les détails et les significations de ces portes illustrent la porte du ciel, attribut caractéristique de la Mère de Dieu dès l’incarnation du Christ. Il semblerait donc que le thème central en soit l’Annonciation. Ainsi, l’étude se propose de montrer la manière dont ce thème a été amplifié et diversifié sous forme de cycle iconographique composé de quatre parties, que l’on peut observer à la fois en peinture et en sculpture. Les sculptures témoignent d’un emploi particulier du langage métaphorique, exprimé d’une manière allégorique et emblématique, à travers laquelle les ‘portes royales’ sont transformées en pièces centrales et complexes de l’iconostase. Plusieurs prophéties concernant la Venue du Sauveur grâce à une vierge ont été choisies et représentées dans la sculpture des ‘portes royales’ de la région des Carpates du Nord, qui devient le centre d’un développement iconographique particulier. Sans doute, les disputes religieuses ont-elles façonné la culture spirituelle des croyants orthodoxes des Carpates, à l’époque turbulente de la pré-modernité. À cet égard, la rhétorique du langage artistique visuel se pose en miroir des témoignages apportés par les documents, les inscriptions et les collections folkloriques des communautés de rite byzantin. Situé à un carrefour de civilisations, l’art sacré de Maramureș contribue à une meilleure compréhension de la signification et de l’évolution de ces ‘portes royales’ à l’époque post-byzantine; mais il nourrit également l’étude de l’histoire de l’art européen dans son ensemble.
More...
The Library of the Orthodox Metropolitan See of Moldavia and Bucovina in Iaşi preserves over a thousand copies of old Greek books. There are only ten manuscripts in this collection, one of which was com-missioned by Constantin Brâncoveanu, Prince of Wallachia. The collection consists mainly of Greek prints of various origins, some of which can be traced back to the library of the Princely Academy of Iași, succeeded by the Mihăileană Academy. Other volumes originate in the library of the Theological Seminary of Socola, founded by Veniamin Costachi Metropolitan of Moldavia, who donated his personal library to the Iași foundation. Sev-eral references come from the private collections of high hierarchs, while some books were collected from various Moldavian monasteries, especially from those who used to be metochia of the Greek Patriarchates and the great monasteries under their jurisdiction. This article evaluates the importance of the prints according to their dating, place of publication, owners, and contents (generally didactic books, but also polemical books of a religious nature). It also seeks to reconstruct the historical context of their circulation in Moldavia and the circumstances in which they came into the possession of the Metropolitan See of Moldavia and Bucovina. The analysis provided takes into account prosopographical investigations, the history of the Moldavian educational institutions, and the examination of the notes (mostly in Greek) on the prints.
More...
L’article nous présente la manière dont trois histoires, avec des finalités très différentes, s’avèrent en réalité interconnectées. La première histoire est celle de saint Antoine Petchersky (xe-xie siècle), père du monachisme russe et fondateur de la Laure des Grottes de Kyïv; la deuxième concerne un monastère du Mont Athos, où ce saint aurait vécu pendant un certain temps au xie siècle; la troisième nous parle d’un objet qu’il aurait porté. La présente étude permet d’explorer la rivalité entre Grecs et Russes au Mont Athos dans la seconde moitié du xixe siècle. Elle permet également d’interroger la question des ‘faux’ objets et la pertinence culturelle de ces derniers.
More...
L’article présente une série d’icônes et d’objets liturgiques provenant du trésor du monastère Rakovica à Belgrade, en Serbie. Plusieurs exemples, datant de différentes périodes, témoignent de l’influence culturelle russe sur le milieu local serbe. Le monastère possède six icônes peintes dans le Palais des Armures du Kremlin à Moscou vers la fin du xviie siècle. Ces icônes, qui comptent parmi les témoins conservés les plus anciens, nous renseignent sur les relations serbo-russes au sein de la vie religieuse de Belgrade. D’innombrables guerres ont jalonné l’existence du monastère Rakovica, ce qui explique que le trésor soit aujourd’hui relativement modeste. Il comprend, par exemple, quelques icônes russes des xixe et xxe siècles, principalement des artefacts produits en série, sans valeur artistique significative. Toutefois, les revêtements en argent de trois de ces icônes nécessitent une analyse approfondie. Aussi, le trésor comprend-il plusieurs livres liturgiques imprimés à Moscou ou dans la Laure des Grottes de Kyïv, de même que deux objets liturgiques.
More...
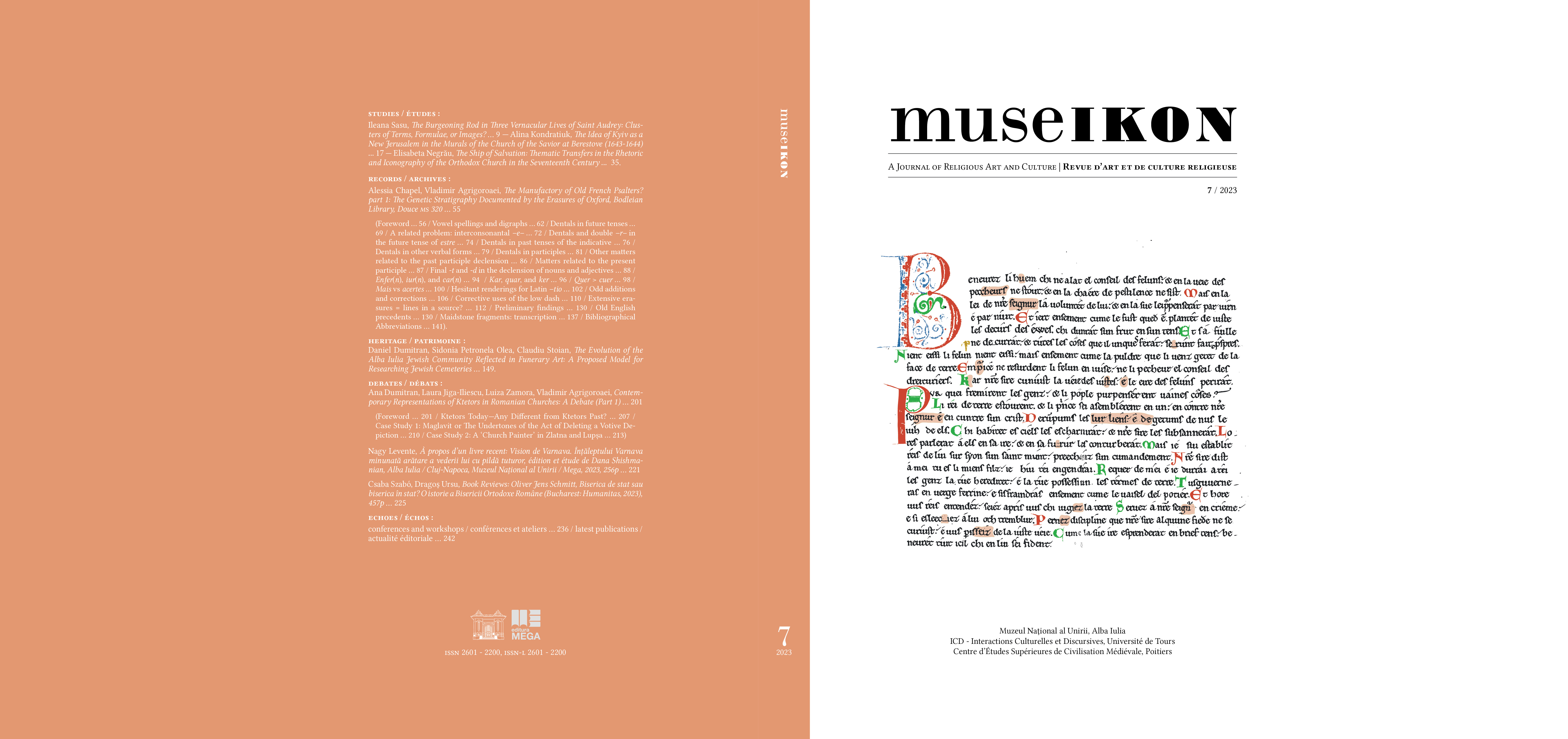
Pentru a înțelege mai bine relațiile intertextuale dintre psaltirile franceze medievale, întoarcerea la o sursă fundamentală precum Psaltirea de la Oxford (manuscrisul Oxford, Biblioteca Bodleiană, Douce 320) este esențială. Astfel, unul dintre scopurile acestui articol este cel de a pune bazele unui studiu al modificărilor de natură textuală reprezentate de numeroase ștersături care reflectă procesul de redactare și spun povestea acestui manuscris. Deoarece studiul este de amploare, a fost necesară segmentarea lui în mai multe publicații. În această primă etapă, după o introducere care analizează relațiile manuscrisului Douce 320 cu alte manuscrise din familia sa (de exemplu, Londra, British Library, Arundel MS 230), autorii discută ștersăturile legate de fluctuația vocalelor și diftongilor în ortografia anumitor cuvinte. Analiza tratamentului dentalelor finale ocupă apoi secțiuni referitoare la anumite forme verbale ale modurilor indicativ, conjunctiv și participiu. Acestea sunt completate de studii privind ștergerea unui -e- interconsonantic în formele de viitor și oscilarea între -r- și dublu -rr- în formele de viitor ale verbului estre. În cele ce urmează, ștersăturile și/sau corecturile legate de dentale permit de asemenea să fie abordată problema declinării, nu numai în cazul participiilor, ci și a mai multor substantive și adjective. Cercetarea se concentrează apoi pe studii de caz: ștergerea unui –n final în enfer(n), iur(n) și car(n); ezitările scribului legate de ortografia conjuncției car; înlocuirea frecventă a lui q cu c în cuvântul quer/cuer; ezitarea între folosirea conjuncției mais sau a conjuncției acertes; precum și multiplele opțiuni de a traduce sufixul latin –tio. O paranteză deschisă cu privire la anumite adăugiri și/sau corecturi sugerează posibilitatea ca manuscrisul Douce 320 să nu fie o traducere autografă a Psaltirii St. Albans (păstrată la Hildesheim, Dombibliothek, St. Godehard 1). Scribul ar fi folosit mai degrabă o sursă latină cu o glosă vernaculară interliniară. Această deducție pare să fie confirmată și de utilizarea unei liniuțe de unire, pe care copistul o folosește pentru a compensa erori probabile de transcriere. Ipoteza aceasta este susținută mai ales de cercetarea asupra câtorva „ștersături lungi”. Ele par a privi unități de transcriere a căror modificare este legată de structura și interconectarea textuală cu o sursă care prezintă atât un text latin, cât și o glosă interliniară. În încheierea acestei părți, după ce au prezentat, spre comparație, exemple preluate din Psaltirea Winchester și Psaltirea Arundel, autorii propun reconstituirea unui segment de text care ar putea fi mai aproape de sursa manuscrisului Douce 320. Articolul se încheie cu o comparație cu precedentele în limba engleză veche și cu o transcriere a fragmentelor de la Maidstone, Centrul și Biblioteca de Istorie Kent, Fa/Z1 (fragmentul Faversham i). Continuarea cercetării este prevăzută pentru următorul număr al revistei Museikon.
More...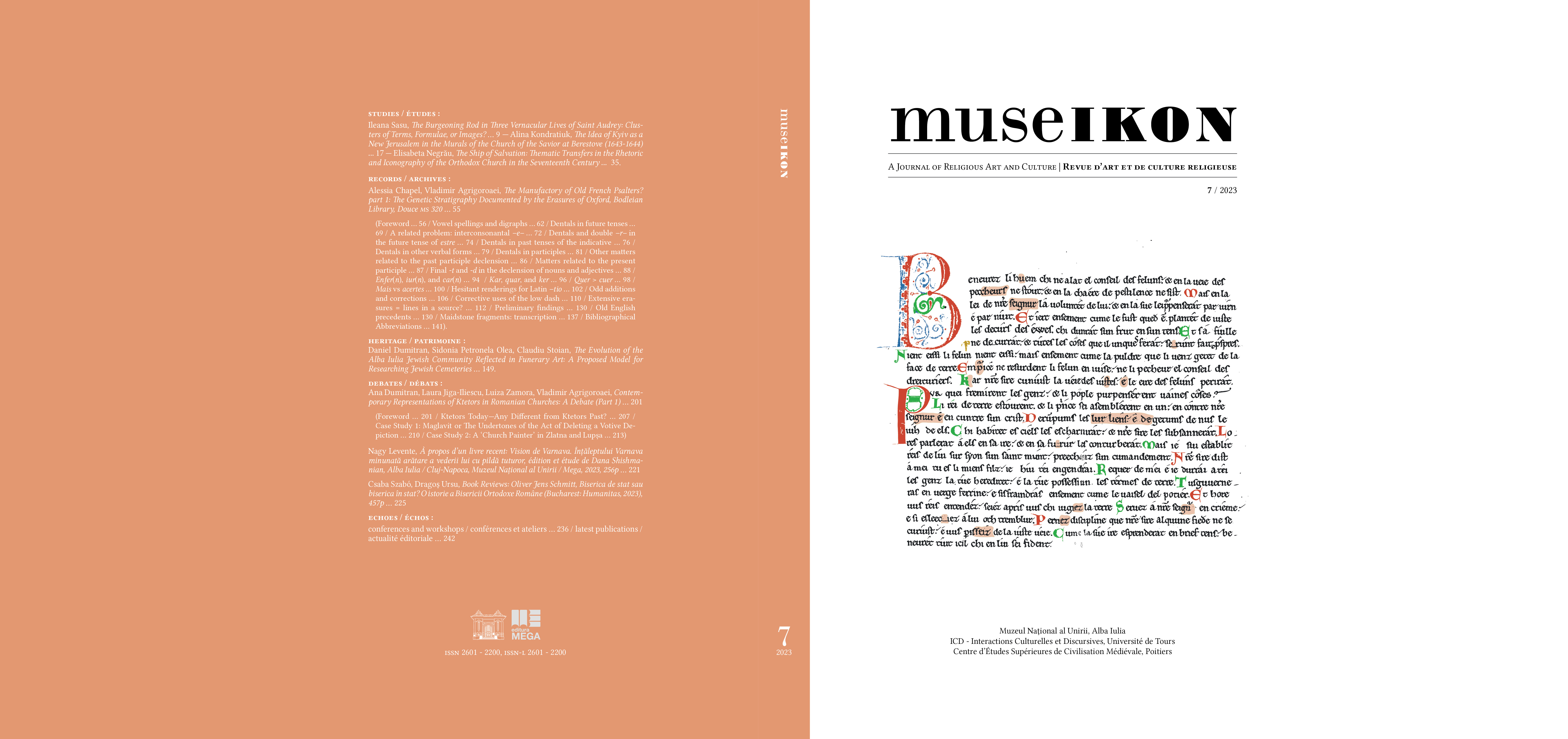
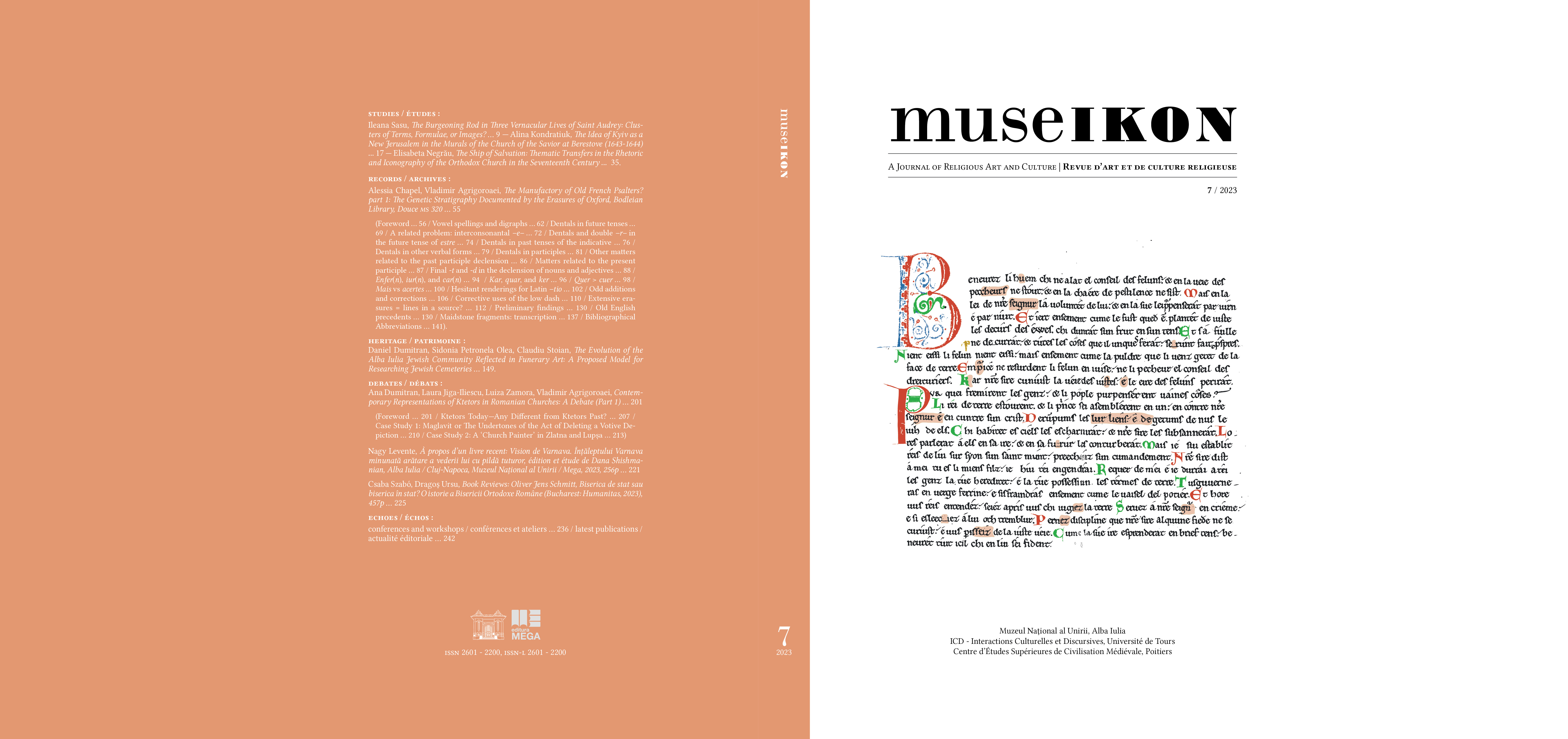
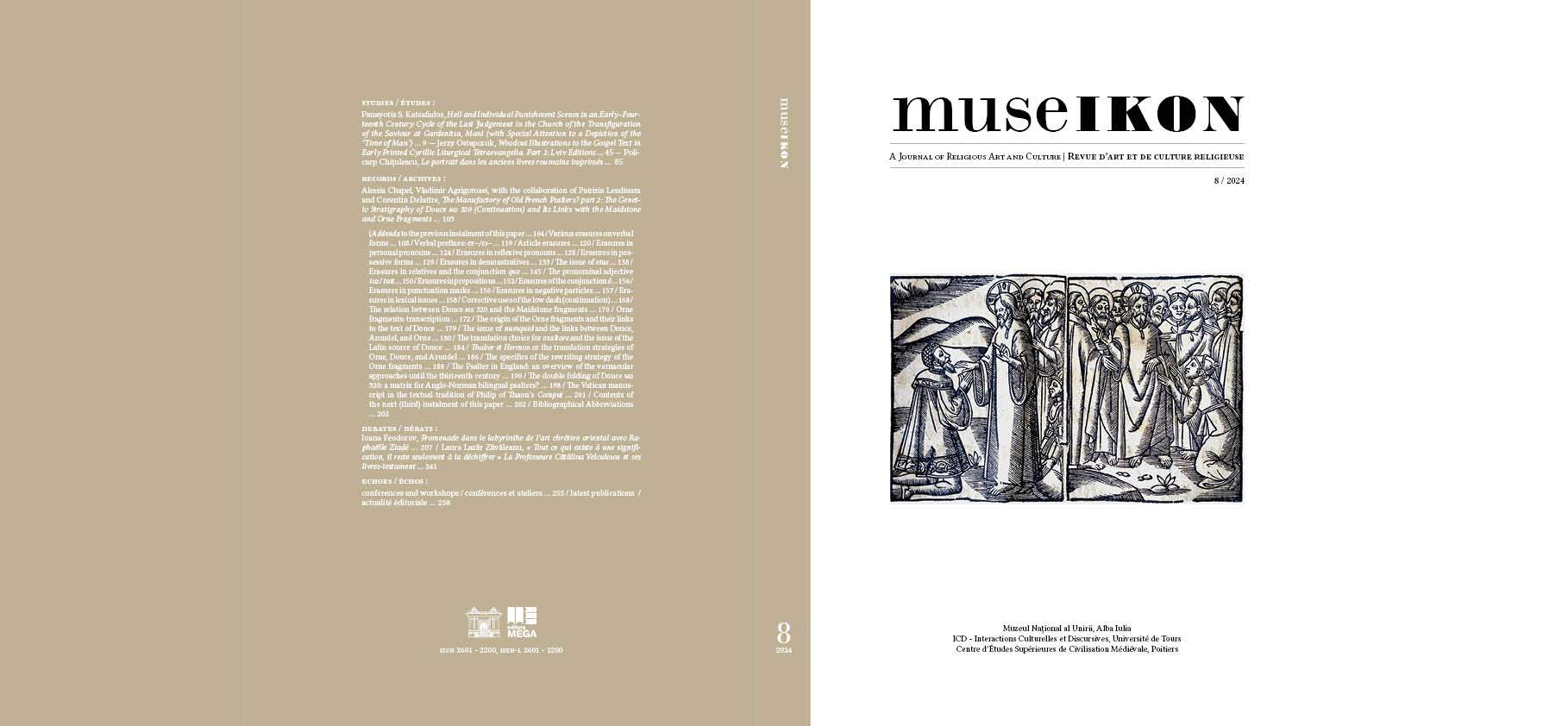
L’une des plus curieuses représentations du cycle du Jugement dernier de la péninsule de Mani (La-conie) peut être admirée dans le narthex de l’église de la Transfiguration, dans le village de Gardenitsa. Les représentations des pécheurs ont été initialement attribuées à un artiste du xviiie siècle, mais des travaux de restauration récents ont remis en question l’ancienne datation en faveur du xve siècle. L’Auteur montre, grâce à une analyse paléographique, que les caractéristiques des lettres et un certain nombre de particularités stylistiques peuvent être attribuées à un peintre local, Nomikos, dont l’oeuvre comprend d’autres églises peintes dans la région au début du xive siècle : l’église Saint-Georges à Marasse / Kitta, l’église Saint-Nicolas à Nymphi et le catholicon du monastère de Phaneromeni. Les peintures et les inscriptions de Gardenitsa pourraient être datées d’environ 1326/1327 et elles seraient, peut-être, parmi les dernières créations du peintre Nomikos. Contrairement aux châtiments individuels de pécheurs tels qu’on les connaît dans les peintures crétoises, chypriotes ou même serbes, le cycle peint sur la voûte ouest de l’église de Gardenitsa présente quelques traits qui le particularisent. Dans les huit cadres, regroupés en deux groupes de quatre sur les côtés nord et sud de la voûte, l’accent est sou-vent mis sur le clergé et les personnes qui lui sont liées (les femmes des prêtres, par exemple). Il n’y a pas de péchés de nature agricole ou familiale, et l’une des scènes représente un personnage mystérieux, ac-compagné d’une inscription qui se réfère au ‘Temps de l’homme’. C’est d’ailleurs la seule représentation d’un pé-cheur à Gardenitsa qui ne trouve pas de terme de comparaison dans les cycles de pécheurs d’autres régions du Commonwealth byzantin. L'auteur identifie un certain nombre de modèles qui semblent avoir fusionné pour créer une représentation entièrement nouvelle. Le premier est certainement la parabole du mauvais riche et de Lazare, dont la place est souvent parmi les scènes accompagnant le Jugement dernier, sauf que le riche représenté à Gardenitsa ne conserve que certaines caractéristiques iconographiques de la scène attendue. Une autre image qui semble avoir été utilisée dans la scène de Gardenitsa peut être celle de l’homme poursuivi par une licorne dans une parabole de l’histoire de Barlaam et Josaphat. L’arbre sur lequel s’appuie le riche de Gardenitsa et les deux chiens noir et blanc (au lieu des souris), symbolisant le jour et la nuit, sont des éléments qui semblent avoir été repris de cet autre modèle. Le troisième modèle pourrait être une série d’images que l’on retrouve dans des psautiers occidentaux. Après un inventaire succinct d’autres représentations occidentalisantes retrouvées dans la péninsule de Mani ou dans le reste du Péloponnèse, l’auteur conclut que les modèles fusionnés par l’artiste de Gardenitsa proviennent de manuscrits. Il pourrait s’agir des mêmes manuscrits que le donateur (aujourd’hui anonyme) semble offrir au Christ dans la scène votive. On suppose que ce fondateur est peut-être à l’origine des innovations iconographiques en question.
More...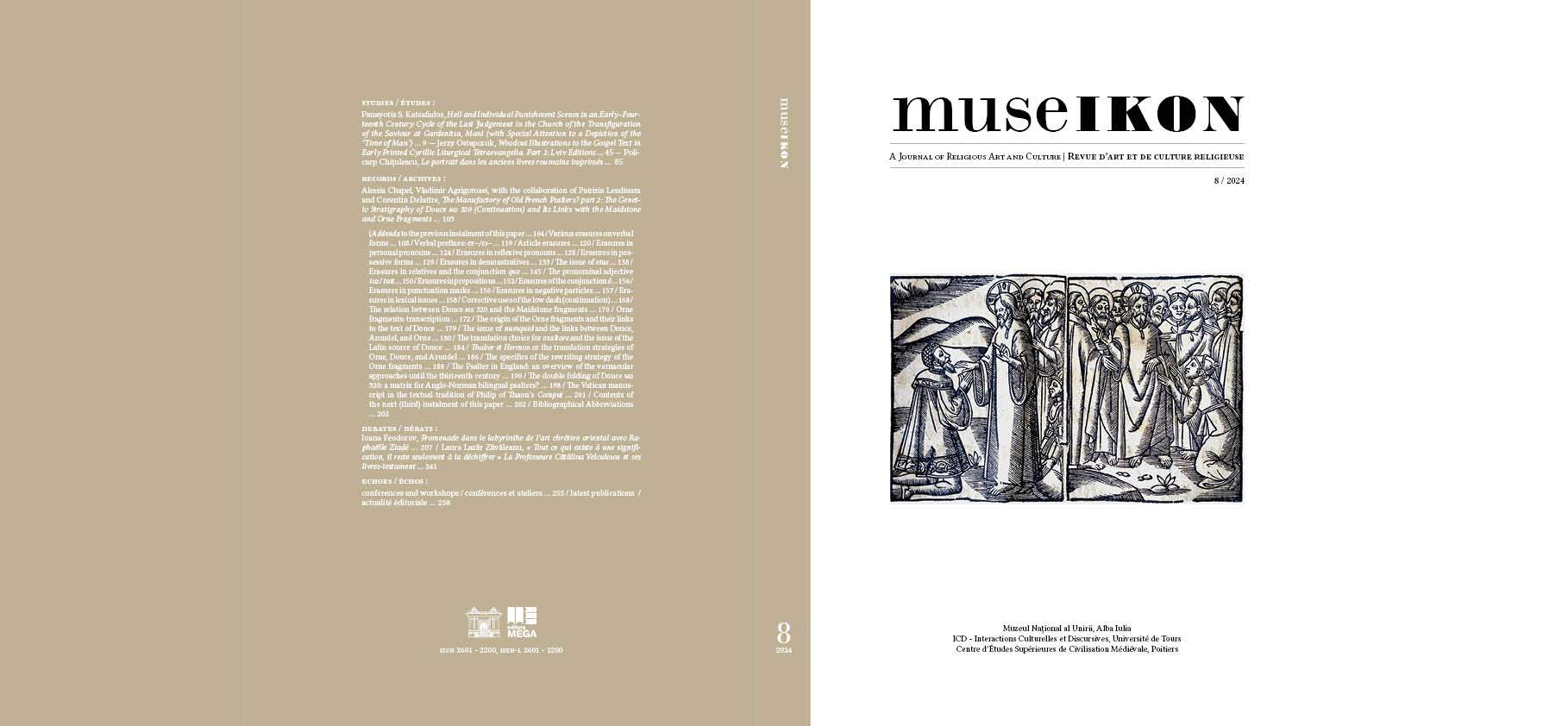
Le présent article se concentre sur les cycles d'images narratives de l'Évangile, présents dans les premiers Tétraévangiles liturgiques imprimés en cyrillique et publiés à Lviv. Les sept éditions des Évangiles publiées par l'imprimerie de la Confrérie de Lviv, ainsi que celle publiée par Mykhailo Slozka, comportent de nombreuses illustrations narratives placées en lien direct avec les versets qui décrivent les scènes représentées. Une étude approfondie de ces cycles évangéliques d'images narratives, ainsi que les changements que les illustrations ont subis dans chaque édition, nous permettent de classer les modèles de représentation en trois groupes, et de diviser les huit Tétraévangiles de Lviv en deux groupes. Deux annexes présentent toutes les images narratives gravées sur bois dans les éditions des Évangiles de Lviv. Le premier appendice contient des représentations d'événements évangéliques dans les Tétraévangiles de Lviv, tandis que le deuxième appendice présente les illustrations narratives de l'édition de Mykhailo Slozka.
More...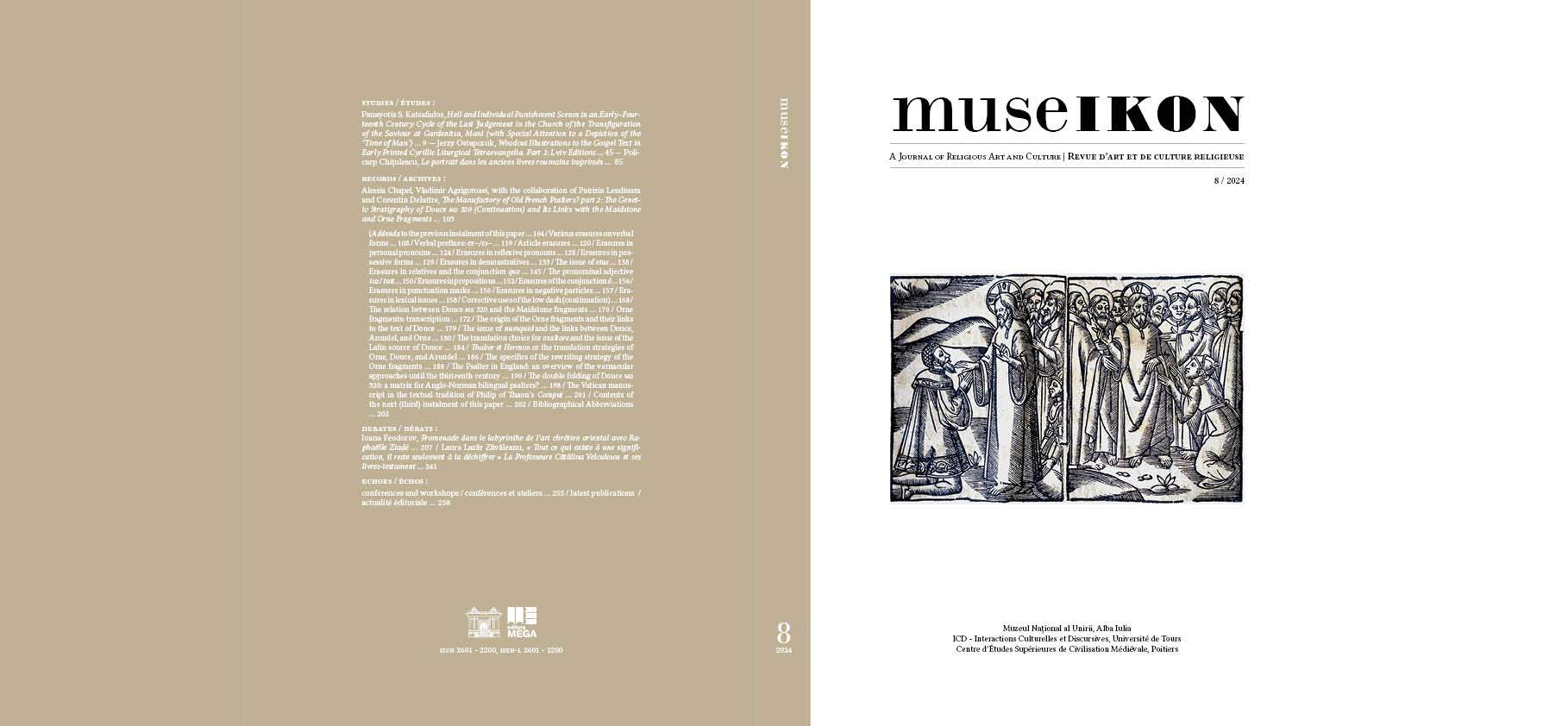
The painted, engraved, or sculpted portrait is an attempt to immortalize a person and preserve their memory. Often, portraits served both didactic and aesthetic purposes, particularly in religious texts. In Orthodox books, portraits typically depicted saints rather than individuals contemporary with the time of the book's publication. It is exceedingly rare for an Orthodox book to include the portrait of a person who was alive at the time of publication or who had passed away relatively close to that date. While the practice of including portraits of individuals associated with a book was common in the West, it is a notable exception in the history of Romanian engraving and printing tradition. In this study, we have sought to identify the individuals and volumes printed in the Romanian Lands up to the nineteenth century in which such portraits appeared. We have also examined the motivations behind the inclusion of these portraits, whether engraved in wood or brass. This research was inspired by the portraits of Elder Paisios of Neamţ († 1794), printed in books by his disciples. We will analyze these representations of the great hesychast and then explore several other portraits we have identified in Romanian books thus far.
More...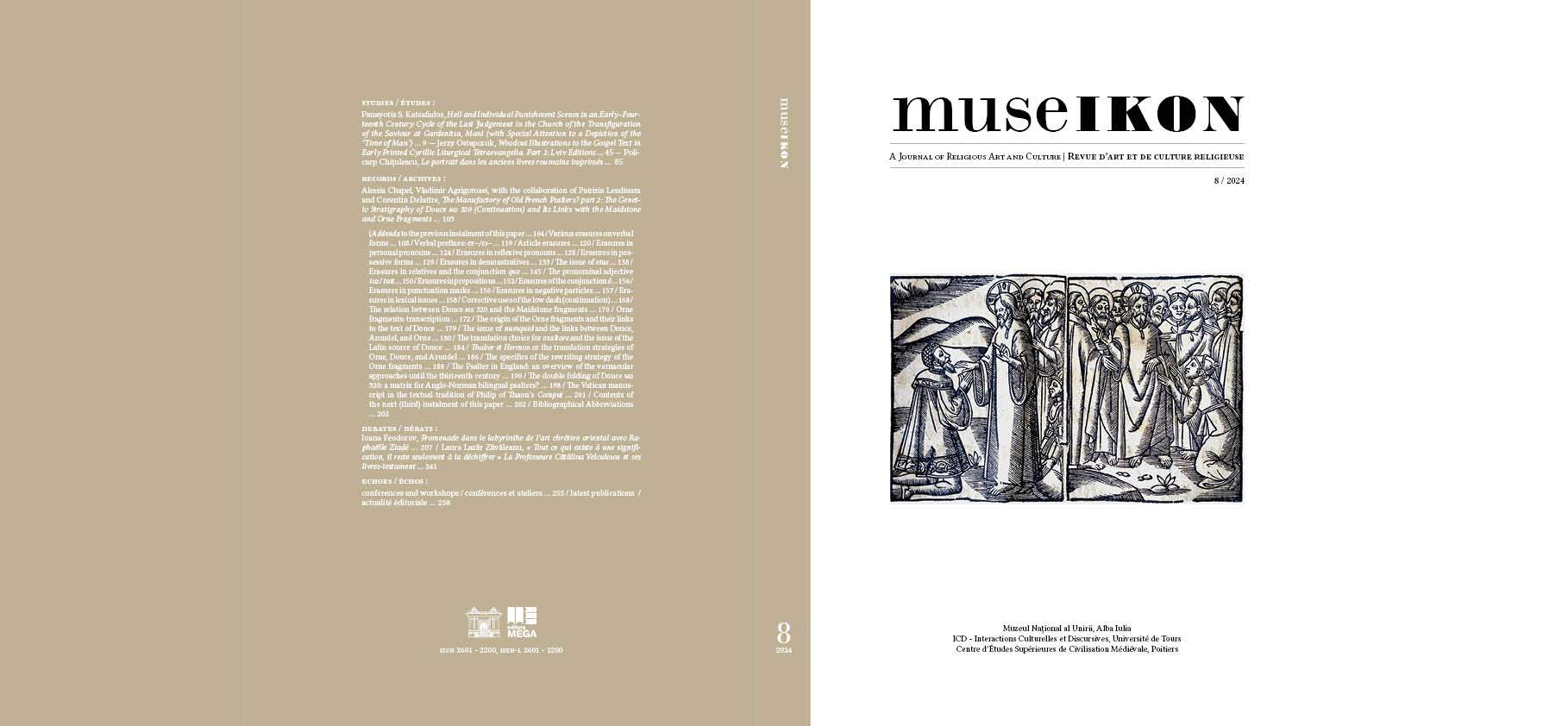
Le présent article s’inscrit dans la continuité de celui qui a été publié en 2023 dans la même revue (The Manufactory of Old French Psalters: Part 1…). Ce deuxième volet comprend d’abord une section de addenda qui complètent certaines parties du précèdent article. S’ajoutent ensuite les érasures dans diverses formes verbales, suivies par un recensement des corrections liées aux préfixes ex– et es–. D’autres séries d’érasures concernent différentes parties du discours: articles définis; pronoms personnels; pronoms réflexifs; formes possessives; démonstratifs; avec une étude de cas sur les choix de traduction du génitif eius, dont plusieurs documentent l’existence d’un antigraphe. Il s’agit souvent d’une hésitation entre les formes faibles et fortes. Des sections com-plémentaires sont consacrées aux érasures des pronoms relatifs et de la conjonction que; à l’adjectif pronominal toz / tuit; aux prépositions; à la conjonction é; aux signes de ponctuation; et aux particules négatives. L’ana-lyse des érasures du manuscrit d’Oxford, Bibliothèque bodléienne, Douce 320 se termine par un examen détaillé des corrections liées à différents phénomènes lexicaux. L’article porte ensuite sur les rapports entre le manuscrit Douce et les fragments de Maidstone, dont la transcription a été publiée dans le premier volet. Suivent une transcrip-tion des fragments de l’Orne (Paris, Archives Nationales, dossier AB xix 1734) et une étude sur l’origine de ces derniers et sur leurs liens avec le texte de Douce. Les choix de traduction pour le latin numquid documentent les liens entre Douce, Arundel (Londres, Bibliothèque britannique, Arundel 230) et Orne. Les choix de traduction du latin exaltare permettent en partie de restituer le texte latin de la source de Douce. Les différentes stratégies de traduction d’Orne, de Douce et d’Arundel semblent être des réécritures d’antigraphes similaires. Toutes ces ana-lyses montrent que Douce, Arundel, Orne et Maidstone proviennent de deux ou plusieurs gloses vernaculaires apparentées. L’article propose ensuite une perspective globale sur les approches vernaculaires de la traduction des psaumes en Angleterre jusqu’au xiiie siècle, qui documente l’interaction des langues vernaculaires anglaises et françaises avec les textes (et l’exégèse) latins. Il se termine par une discussion (appuyée sur deux exemples du xiie siècle) concernant le double pliage du Douce, lié sans doute à sa circulation et à son emploi dans la réalisation des psautiers bilingues à deux colonnes. Le troisième volet du présent article est prévu pour 2025. Il comprendra la transcription du texte de Douce (avec l’accentuation originale et l’emplacement des érasures), ainsi que plusieurs études complémentaires.
More...