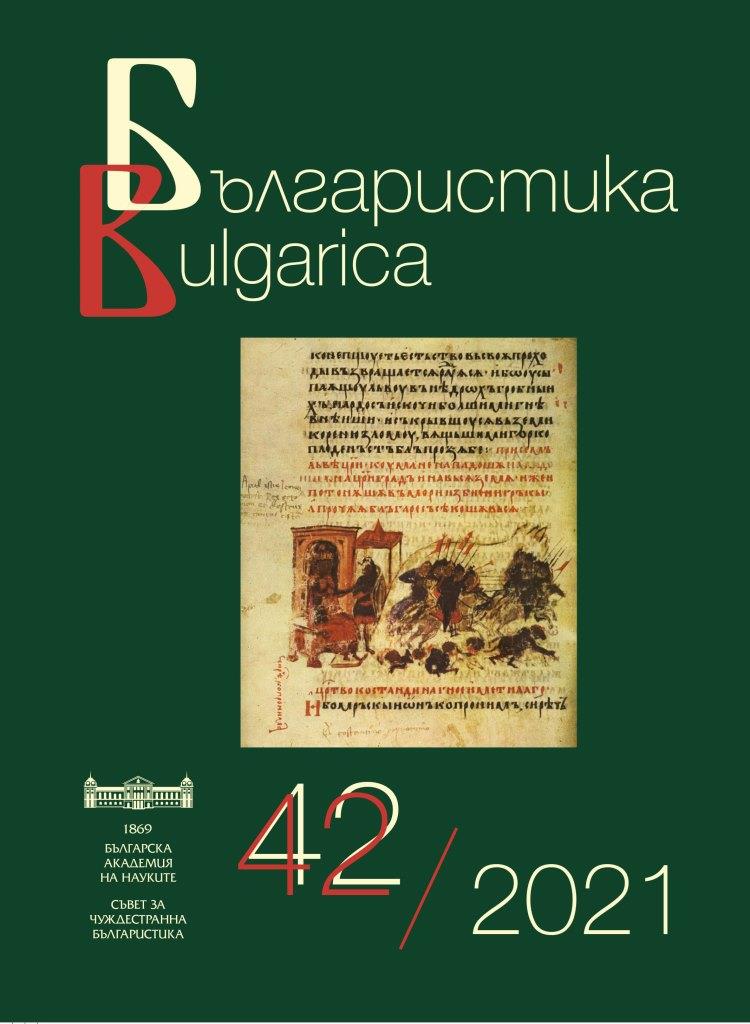
Книги 2020 – 2021
Selected bibliography in the field of Bulgarian Studies published in the current year.
More...We kindly inform you that, as long as the subject affiliation of our 300.000+ articles is in progress, you might get unsufficient or no results on your third level or second level search. In this case, please broaden your search criteria.
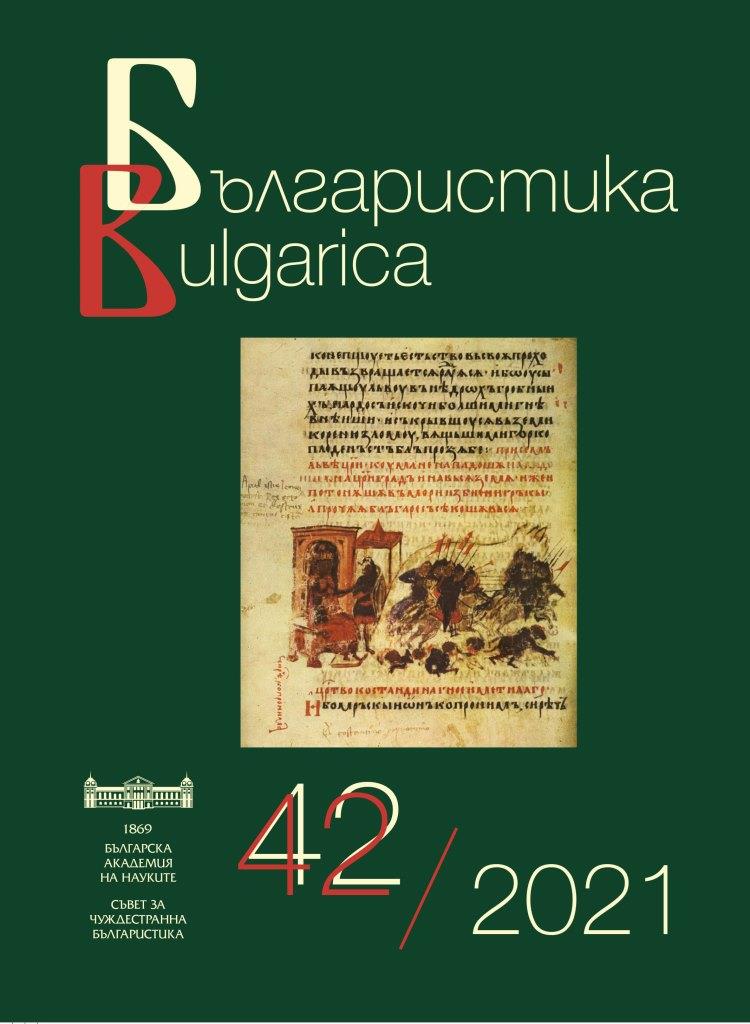
Selected bibliography in the field of Bulgarian Studies published in the current year.
More...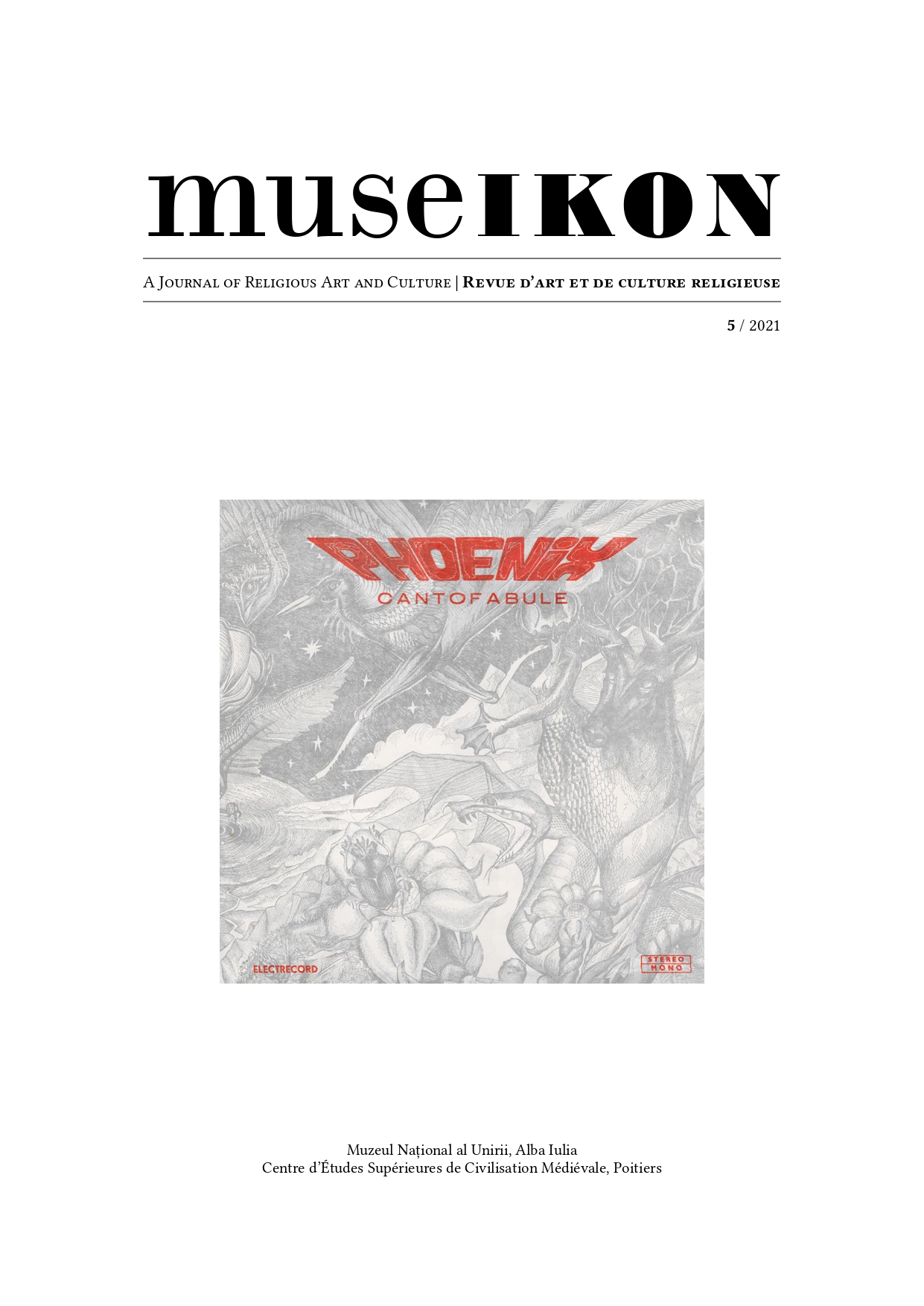
En 1629, une ambassade dirigée par l’archimandrite Varlaam est arrivée à la cour du tsar Mikhaïl Féodorovitch Romanov, demandant la permission de passer une commande aux peintres moscovites, afin depeindre deux icônes pour le prince Miron Barnovschi. Les sources documentaires nous renseignent sur la dédicacedes icônes et sur le fait qu’elles appartenaient à la typologie des icônes hagiographiques, avec des portraitsde saints au milieu et des scènes narratives de leur vie sur les bords. Bien qu’achevées et payées intégralementpar le prince moldave, les icônes ne sont jamais parvenues à leur commanditaire. Le patriarche Philarète Nikititchles a retenues à Moscou sous prétexte qu’elles étaient ‘inconvenablement’ peintes. Sept ans plus tard,alors que Varlaam occupait le poste de métropolite de Moldavie, le prince Vasile Lupu envoya une autre ambassadeà la cour de Moscou, pour tenter de les récupérer. Le tsar organisa une enquête, les peintres furent interrogéssur les modèles suivis, mais le résultat resta le même : les icônes avaient été peintes de manière noncanonique et ne pouvaient pas être remises aux messagers moldaves. L’enquête sur cet intéressant ‘échec’ diplomatique fait l’objet de la présente étude. En suivant André Grabar, qui soulevait pour la première fois laquestion du prétendu manque de canonicité de ces icônes, l’article reprend toute la question des causes possiblesdu refus inhabituel des autorités moscovites de les remettre à leurs commanditaires. En corroborant lesinformations documentaires avec l’analyse des sources visuelles disponibles, dans le contexte plus large de lacommande des icônes et de l’évolution du culte de saint Jean le Nouveau à l’époque, l’étude suggère qu’uneraison possible de ce rejet pourrait être la représentation du martyr de Suceava – et ce, non pas parce qu’ils’agissait d’un saint inconnu en Russie à l’époque (cf. A. Grabar); mais surtout à cause de l’utilisation d’uncertain modèle iconographique employé dans l’entourage du métropolitain Anastasie Crimca. Ce modèle étaitsans doute susceptible d’avoir déplu au patriarche Philarète Nikititch. Varlaam connaissait bien ce type dereprésentation et avait probablement donné des instructions précises aux peintres moscovites, qui les ont sansdoute suivies à la lettre. En effet, à la suite de cet épisode, Varlaam enverra également au tsar une hagiographie etune icône de saint Jean le Nouveau, qui semblent avoir dynamisé le culte et les représentations iconographiquesdédiées au martyr de Suceava en Russie à la même époque.
More...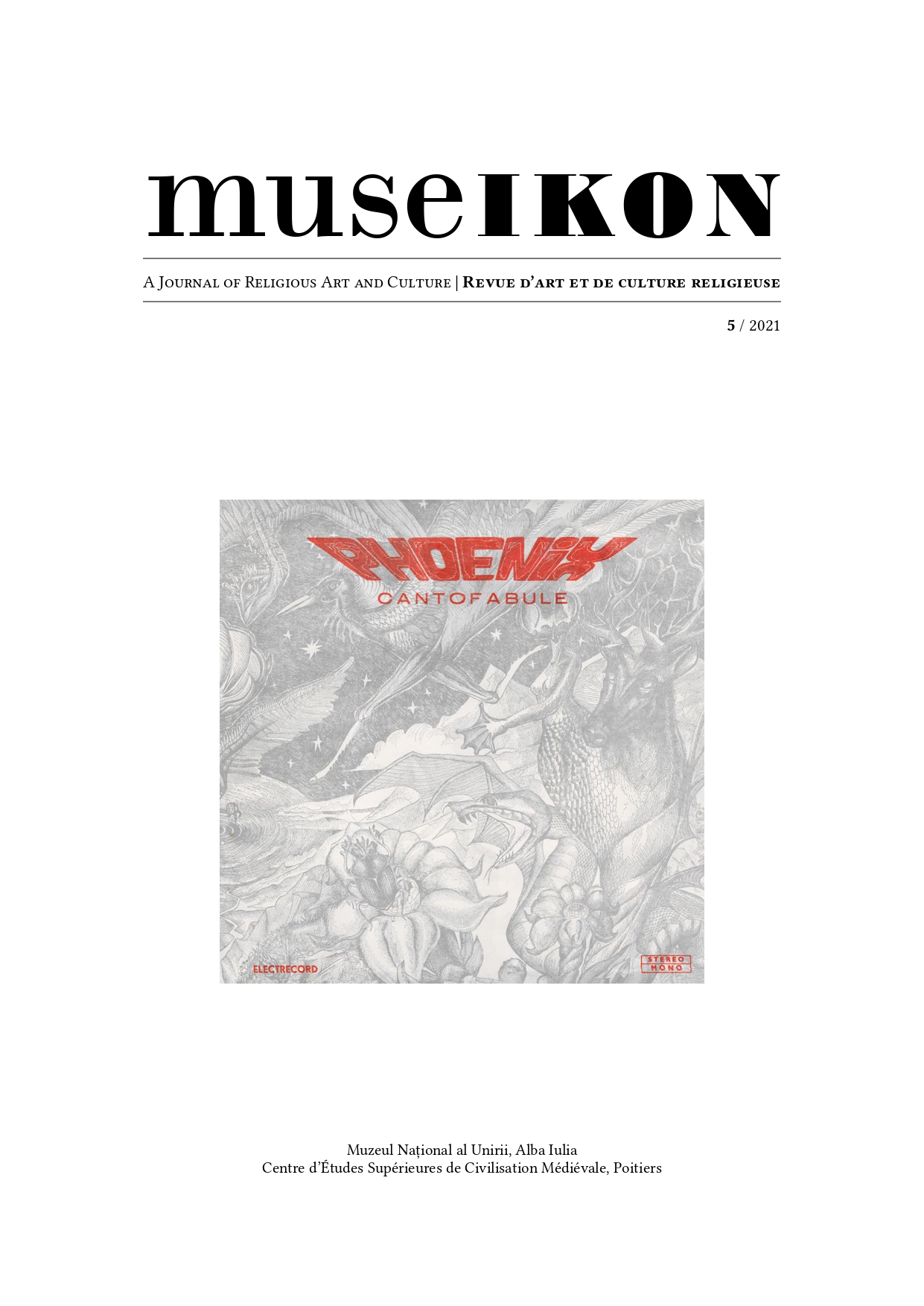
L’étude collective de cette inscription s’inscrit dans lecadre du projet erc Starting Grant graph-east (2021-2026), financé par le programme de recherche et d’innovationHorizon 2020 de l’Union européenne dans le cadrede la convention de subvention n° 948390. Son but est d’étudier les inscriptions et graffitis en alphabet latin de la Méditerranée orientale, de la Grèce à l’Égypte en passantpar la Turquie, la côte syro-palestinienne et Chypre, du VII au XVI siècle.
More...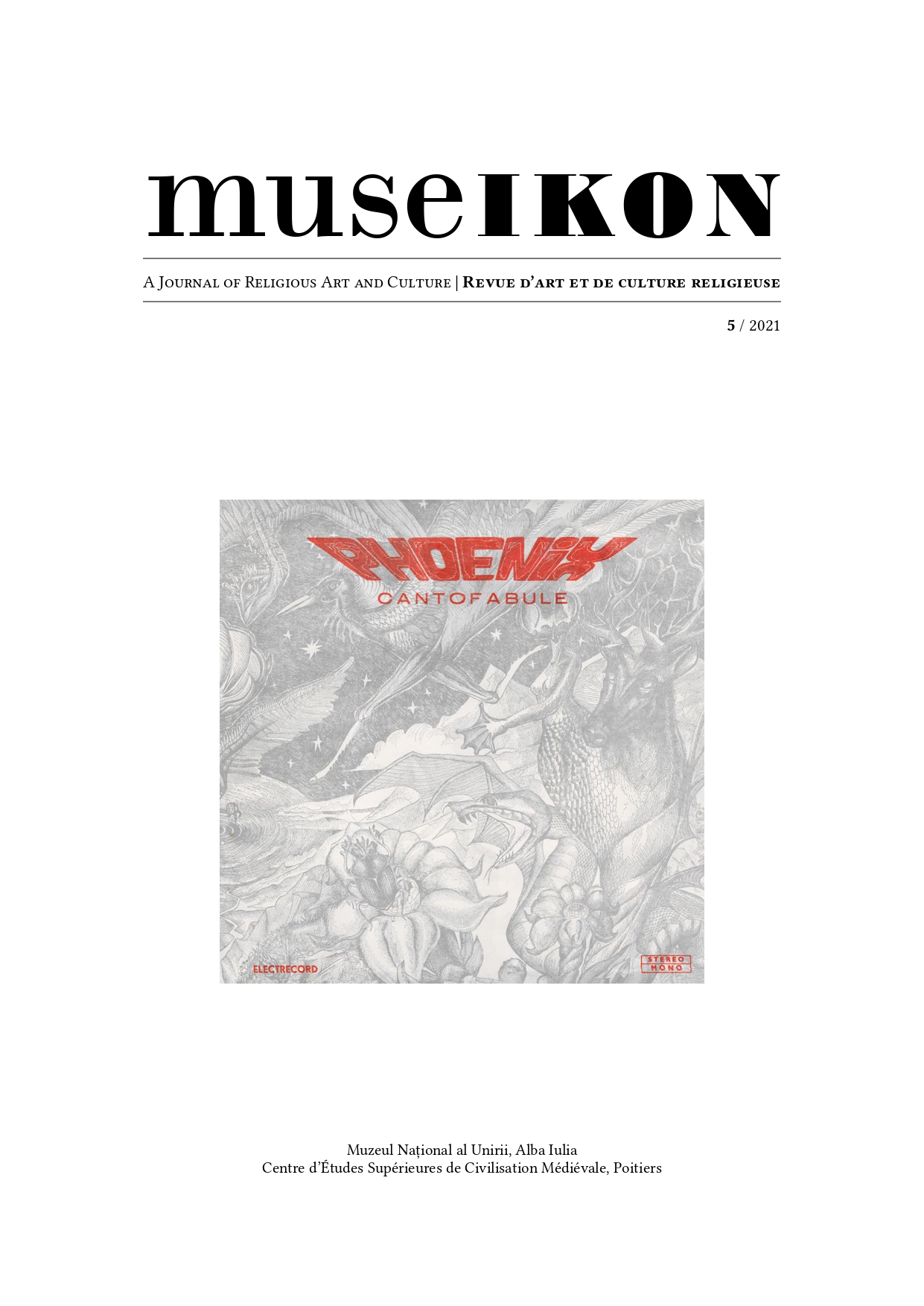
Philologists and medievalists rarely deal with the subject of contemporary Pop-Rock or Folk music. When they do it, they usually fall prey to a certain form of medievalism. The current section of Museikon follows a completely different approach. The pairing of interviews with memoirs and the introduction shaped in the form of an actual scientific study have the sole purpose of launching an experiment in the history of culture. The case study is a 1976 album of the Romanian Rock group Phoenix. The state owned record company Electrecord made a mistake, releasing it as Cantofabule, even though its correct title was Cantafabule or Bestiar. It had traditional- and medieval inspired lyrics, but most of all, it was the result of artistic synergy. A collective work of sorts, much in the manner of the medieval manuscripts of old.
More...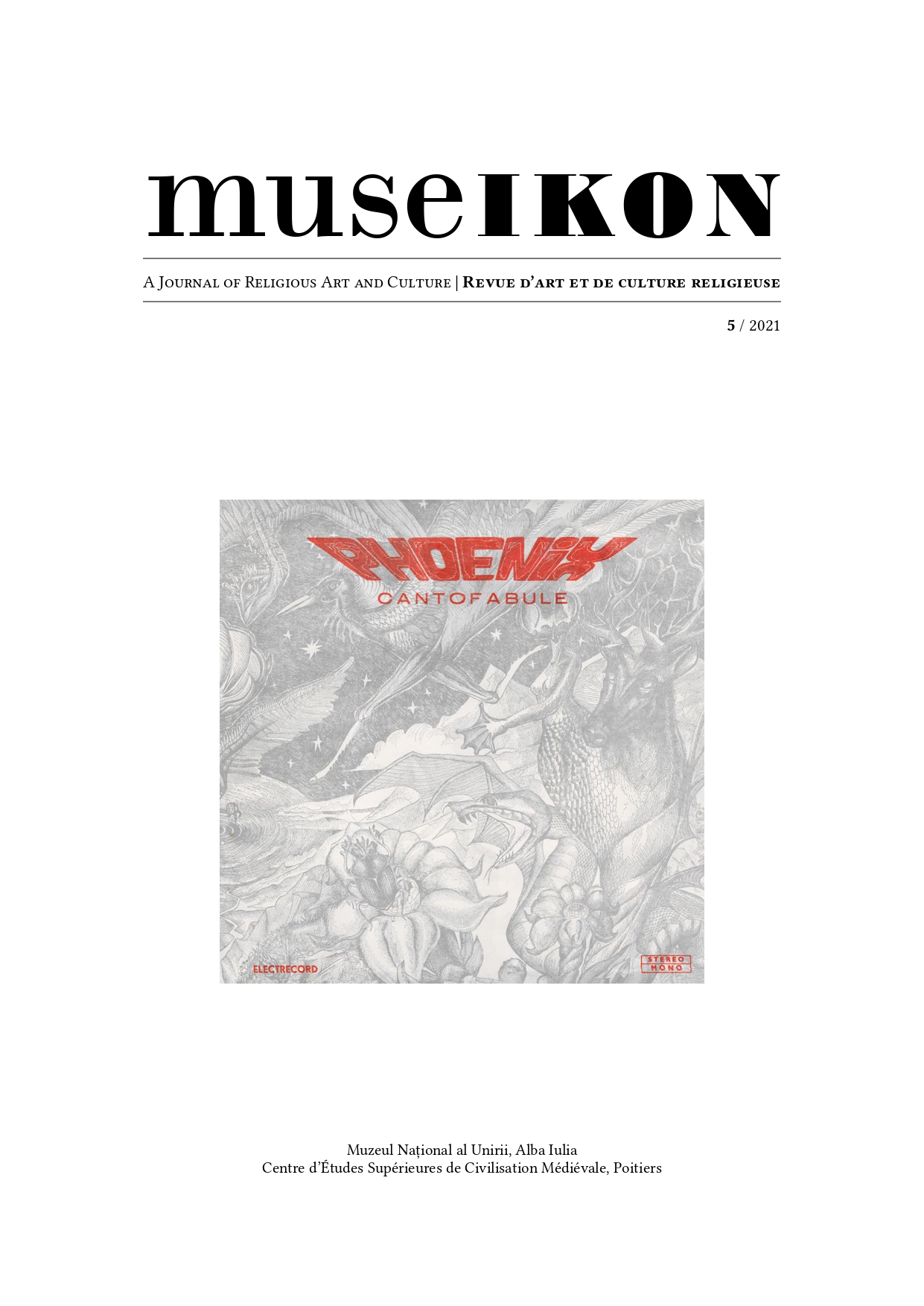
L’article présente l’histoire des fouilles archéologiques polonaises à Faras, au Soudan, dans le contexte des changements politiques de la seconde moitié du xxe siècle, à partir des découvertes qui ont eu lieu avant quele professeur Kazimierz Michałowski ne commence les fouilles archéologiques en 1961. Les recherches des archéologues américains (1907-1910), allemands (1907-1908) et britanniques (1911) sont discutées par la suite, demême qu’une documentation iconographique, suivie par les différentes étapes des découvertes de la cathédralede Faras et des peintures murales au cours de quatre campagnes archéologiques polonaises, achevées en 1964, enrelation avec l’activité de Kazimierz Michałowski. La suite concerne l’histoire et la manière dont le professeur Michałowski a annoncé ses découvertes au Soudan, ainsi que les expositions individuelles, voire temporaires, dans les pays européens, surtout au Musée national de Varsovie, et une exposition permanente préparée dans lacapitale de la Pologne en 1972. L’article étudie aussi la manière dont le régime communiste a influencé la présentation des découvertes et comment les Polonais ont souhaité présenter l’art chrétien pendant la répression du Catholicisme dans leur pays, à une époque dominée par la censure de toutes les expositions et publications scientifiques. En conclusion, cette recherche évalue les résultats de l’étude scientifique des monuments fouillés lors des campagnes archéologiques, et propose la vérification (à l’avenir) de la datation des pièces polychromes, de mêmequ’une discussion de l’ensemble du programme iconographique de l’intérieur de la cathédrale de Faras.
More...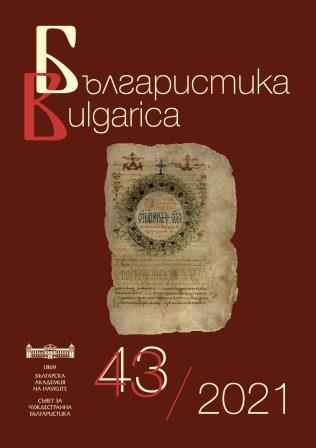
Selected bibliography in the field of Bulgarian Studies published in the current year.
More...
Selected bibliography in the field of Bulgarian Studies published in the current year
More...
Data about scientific events in the field of the humanities in Bulgaria in 2015Content of the main Bulgarian scientific journals for the current year in linguistics, literature, history, folklore, ethnography, archaeology and art studies.
More...

Un siècle après la publication des premières recherches sur l’église Sainte-Parascève de Tălmăcel, de nouvelles études permettent de reconstituer l’histoire de la fondation du village transylvain à la fin du xviiie siècle. Elles mettent en évidence la valeur architecturale et le caractère représentatif des composantes artistiques dont l’église du village a été dotée à différents moments historiques; caractéristiques qui ont déterminé le classement de cette église en tant que monument historique. La présente étude se propose de réexaminer les recherches publiées jusqu’à présent et poursuit l’investigation grâce, entre autres, aux apports fournis par la restauration de l’ensemble mural. Les informations inédites identifiées dans les documents, les notes transcrites dans les anciens livres liturgiques des archives paroissiales, permettent d’identifier la signature de l’artiste Ioan de Poplaca, à qui l’on devrait certaines parties de la peinture murale de l’église. Sa contribution, jusqu’ici inconnue, peut être désormais différenciée de celle de l’autre peintre, Panteleimon. La différenciation de leur activité à Tălmăcel permet de mettre en évidence quelques particularités stylistiques propres à chacun de nos deux artistes; caractéristiques qui, par analogie, nous pouvons également identifier dans d’autres de leurs oeuvres. À titre subsidiaire, l’article permet de reconstituer leurs biographies.
More...
This study identified the icon of Virgin Moscovita and the icon of the Holy Mandylion, described in Konstantinos Dapontes’ writings, with the icon of the Virgin and the icon of the Holy Mandylion preserved in his family monastery Evangelistria in Skopelos island. We can now retrace the “biography” of these two artefacts, the history of their creation, donation, and multiple “transfers” of the two icons. This study is an important contribution to the history of the early modern period in the Balkans. The icon of the Virgin Moscovite was donated to Konstantinos Dapontes by his benefactor Konstantinos Mavrocordatos in 1741 in Iasi, and the the icon of the Holy Mandylion was donated to Dapontes by his “maître spirituel”, the patriarch of Antioch Sylvester in 1762.
More...
Le musée ‘Trésors spirituels de l’Ukraine’ à Kiev comprend plus de 400 icônes allant du xve au xixe siècles. Dans cette collection, plusieurs exemplaires témoignent d’une série de traits stylistiques indiquant que leur origine pourrait se situer dans la Ruthénie des Carpates, de Pokutia ou de Maramureș. Ces icônes se caractérisent par une forme simplifiée; une palette de couleurs limitée; une composition schématique; des formes stylistiques bien connues aux siècles précédents; un fond doré gravé; et des cadres en bois particulièrement sculptés. Le présent article décrit six de ces icônes : l’icône de la Mère de Dieu sur Trône, peinte par Michail Popovich de Kolomyia, dont les oeuvres se trouvent dans les églises de Budeşti-Josani et de Budeşti-Susani ; l’Annonciation de la fin du xviie siècle, oeuvre du peintre d’icônes de Hǎrnicești à Maramureș et Bǎlan-Josani ; une icône du xviiie siècle, la Descente du Saint-Esprit, peinte dans un style similaire à celui de l’icône de Saint Nicolas de Shelestovo, près de Moukatchevo (aujourd’hui au Musée de l’Architecture et de la Vie Populaires d’Oujhorod) ; et trois icônes – Christ Pantocrator, Théotokos Hodegetria et Archange Michel – provenant du même atelier que les Trois Saints Hiérarques du Musée d’Ethnographie Régionale d’Ivano-Frankivsk.
More...
Au xviiie siècle, des peintres ukrainiens et serbes formés à l’école d’art de la Laure de Kyïv-Petchersk ont inauguré le processus de changement de la peinture religieuse serbe qui, dans la région administrée par le siège métropolitain de Karlovci, est passée d’un style ‘traditionnel’ (ou ‘manière post-byzantine’) à un style plus ‘occidental’ (‘baroque’). À première vue, il pourrait sembler inhabituel que les influences occidentales décisives pour la peinture serbe du xviiie siècle ne soient pas arrivées directement de l’Occident – à savoir de Vienne, l’un des principaux centres de l’art baroque européen et capitale de l’empire dont le territoire englobait le métropolitain de Karlovci -, mais de l’espace artistique ukrainien, déjà ‘occidentalisé’ par les courants venus de la Laure de Kyïv-Petchersk. Vers le milieu du xviiie siècle, cette Laure de Kyïv-Petchersk et son Académie de théologie étaient devenus des soutiens religieux solides et fiables pour l’Orthodoxie, sous la protection politique du tsar de Russie, et promouvaient la science théologique, peut-être la plus forte de la sphère orthodoxe de l’époque. En conséquence, l’Académie de théologie de Kyïv avait commencé à occuper une place de plus en plus importante dans la topographie chrétienne de l’Europe de l’Est. Cette école accueillait des étudiants de toute l’Ukraine et de la Russie, mais aussi des Biélorusses, des Polonais, des Lituaniens et des Serbes. Au xviiie siècle, sur une période de trente ans, 28 Serbes ont reçu une éducation à l’Académie de théologie de Kyïv. De même, au milieu du xviiie siècle, des missionnaires de Kiev rejoignent la communauté de Karlovci, sur invitation des dignitaires de l’Église serbe, en apportent avec eux une aide spirituelle indispensable. L’arrivée dans la commu-nauté de Karlovci des premiers enseignants, peintres, livres et icônes en provenance de Kiev, est marquée aussi par l’arrivée de certains modèles politiques russes. Dans les rangs des intellectuels, plusieurs peintres serbes ont été formés à Kyïv, dont les principaux représentants de la première vague d’européanisation dans la peinture serbe: Dimitrije Bačević et Stefan Tenecki. Le moment décisif pour l’ouverture de la peinture serbe à la peinture kyïvienne occidentalisée s’est produit grâce à l’initiative du patriarche Arsenije iv Jovanović Šakabenta (1725-1748). En effet, en 1743, ce patriarche avait officiellement interdit, dans une lettre circulaire, le travail de tous les soi-disant peintres d’icônes inexpérimentés et non éduqués qui travaillaient à l’ancienne. C’est à cette époque qu’il avait fait appelé à sa cour l’Ukrainien Jov Vasilijevič (vers 1700-après 1760), un maître qui allait donner une nouvelle forme aux courants de l’art serbe. La lettre mentionnée du patriarche Šakabenta indique que les peintres serbes de Karlovci pouvaient apprendre le métier auprès de son peintre de cour autour duquel, semblerait-il, s’était formé la première école de peinture jamais fondée dans le milieu culturel serbe. À travers cette école, le maître Jov Vasilijevič et ses collaborateurs allaient exercer une influence décisive sur toute la génération des peintres (civiques) serbes – ainsi qu’en témoigne l’abandon de l’ancienne manière. L’in-fluence culturelle et artistique ukrainienne dans le siège métropolitain de Karlovci a perduré des années 1720 aux années 1760. Durant cette période, tous les éléments occidentaux ont, sans doute, dû être soumis à la super-vision des théologiens orthodoxes orientaux de Kyïv. Dans la seconde moitié du xviiie siècle, plus précisément à partir de la huitième décennie, les liens culturels et spirituels ukrainiens-serbes ont commencé à s’affaiblir en raison du déclin des liens politiques russes-serbes. Avec le déclin de la sphère artistique de Kyïv, les modèles artistiques et culturels en provenance directe de Vienne se sont alors renforcés. À partir de cette époque, c’est l’Académie de Vienne qui était destinée à former les peintres serbes, apportant dans leur pays des éléments occidentaux et le style de la peinture autrichienne.
More...
Le Musée Ethnographique de Budapest conserve une icône en mauvais état qui provient de Patakófalu (Stara Stuzhytsya), plus précisément de l’éparchie de Moukatchevo. Sur l’une des faces se trouve une repré-sentation Éléousa de la Mère de Dieu, un type iconographique qui était extrêmement populaire dans le sud de la Pologne – de même qu’en Hongrie – à partir du dernier quart du xviie siècle. Certaines icônes appartenant à ce type étaient même considérées comme étant miraculeuses. Associée à une certaine signification, la Mère de Dieu était peinte pour demander la protection contre le danger et les souffrances futures. Sur l’autre face de l’icône se trouve une scène de la Crucifixion avec des personnages demandant l’intercession, dont un homme portant le costume d’un noble et sa famille. L’inscription votive en ruthène a été transcrite sur le fond de la scène. La signature du peintre permet d’identifier Stefan Wiszeński de Sądowa Wisznia. Dans le présent arti-cle, une photographie conservée au Musée National de Lviv, ainsi que des urbaria, permettent de déchiffrer l’inscription et de comprendre les circonstances de la commande.
More...
Au cours de la première moitié du xviiie siècle, les réformes de l’Église Orthodoxe Serbe de Hongrie se reflètent aussi dans la peinture des églises. L’établissement de liens étroits avec le Patriarcat de Moscou et la Laure des Grottes de Kyïv-Petchersk a augmenté l’influence russo-ukrainienne dans le siège métropolitain de Karlovci. On constate un éloignement de plus en plus prononcé face à l’iconographie traditionnelle et une ac-ceptation des reformes connues dans la peinture baroque ukrainienne. Le moment décisif est représenté par l’arrivée du peintre ukrainien Jov Vasilijevič en 1742. Avec le soutien du patriarche Arsenije iv, Vasilijevič fonde une école de peinture à Sremski Karlovci. Par décision du patriarche, cette école devient obligatoire pour tous les peintres d’icônes du siège métropolitain. Un décret scelle l’entrée des nouvelles modes d’expression artis-tique dans l’art ecclésiastique. Jov Vasilijevič exécute plusieurs oeuvres importantes. Il peint les iconostases des monastères de Krušedol et Bodjani; il réalise des peintures pour le patriarche; il forme plusieurs élèves qui con-tinueront à répandre cette influence de la peinture baroque ukrainienne. L’article se propose d’étudier ce style de peinture, devenu une véritable norme dans l’art religieux du siège métropolitain de Karlovci dans les années 1740-1770.
More...
Cette publication examine quatre icônes, qui peuvent être comparées à la production artistique d’un atelier de peinture d’icônes conventionnellement nommé « Belz-Drohobych ». Cet atelier de la Galice ukrainienne – dont la localisation géographique demeure toutefois difficile à établir – se démarque par son style artistique particulier: un ‘laconisme’ graphique rigoureux, à la fois imagier et décoratif. Ses oeuvres les plus représentatives proviennent de la ville de Belz et de la ville de Drohobych, des villages de Hrushiv et Kulchytsi (région de Lviv). Les icônes ici étudiées proviennent, en revanche, du territoire de la région roumaine de Mara-mureș. Il s’agit des icônes de Sainte Paraskevi et de l’Archange Michel du village de Budești-Susani, de l’icône de Saint Jean-Baptiste du village de Breb, et de celle de Sainte Paraskevi (probablement du Maramureș), réalisée par un certain Maître Toma. Pour la première fois, toutes ces oeuvres sont actuellement en cours de restauration. Un bref état de l’art de la recherche les concernant précède l’analyse comparative proprement-dite. Ce qui ressort de cette analyse c’est que, sur la base de l’iconographie et de la stylistique, les quatre icônes du Maramureș s’avè-rent assez proches des icônes de « Belz-Drohobych ». Cela permet de proposer une datation des icônes de Sainte Paraskevi et de Saint Jean Prodrome dans la seconde moitié du xve siècle. En ce qui concerne l’icône de l’Archange Michel, les auteurs proposent une datation au xvie siècle. Cependant, l’icône nécessiterait une étude ultérieure après sa restauration. Enfin, l’icône de Sainte Paraskevi, réalisée par Maître Toma, semble bien s’inspirer des oeuvres de l’atelier « Belz-Drohobych », mais d’un point de vue stylistique, elle se réfère à une période ultérieure: fin du xvie siècle-début du xviie siècle.
More...
‘After preaching, they feasted quite lavishly every day, they chose new lovers almost every night, they spent their time without being subjected to anyone, without worries, without fatigue, without danger’. In his Super Apocalypsim, the Cistercian monk Geoffrey of Auxerre describes in this way two Waldensian lady preachers, delineating an extraordinary condition of female autonomy. The article explores the ‘textual phy-siognomy’ of Super Apocalypsim, a biblical commentary written in the second half of the 1180s, but also high-lights its historical and editorial context. The testimony of Geoffrey of Auxerre, a leading representative of ecclesiastical hierarchies, allows us to analyse lexical choices and conceptual nuclei in order to clarify the speci-fic polemics underlying this description of the subversive life of an order which is represented by the two Waldensian women and the manner in which they experience female freedom. Emphasis is given to the issue of a dangerous ‘upside-down world’ (mundus reversus et perversus); this witnesses the subversive experience of the two Waldensian women. The article also recognises possible surviving traces of a radical evangelism and the attempt to create a new world (mundus novus).
More...
Selected bibliography in the field of Bulgarian Studies published in the current year.
More...
Content of the main Bulgarian scientific journals for the current year in linguistics, literature, history, folklore, ethnography, archaeology and art studies.
More...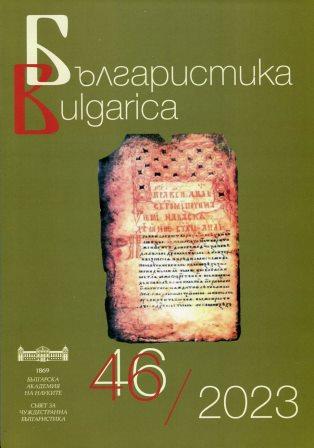
Data about scientific events in the field of the humanities in Bulgaria in the first half of 2023.
More...